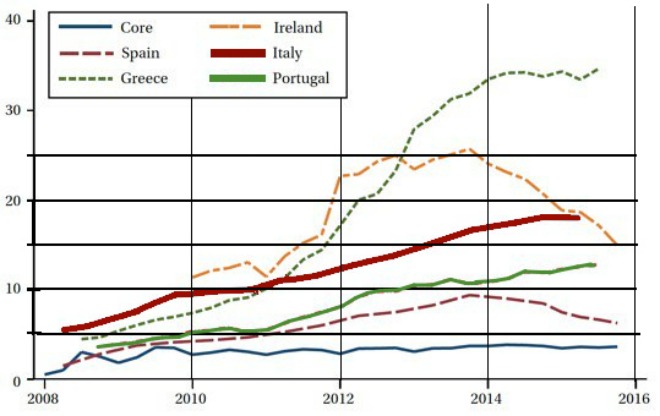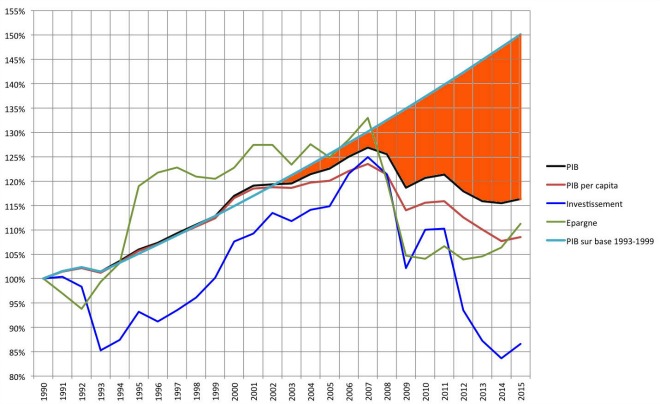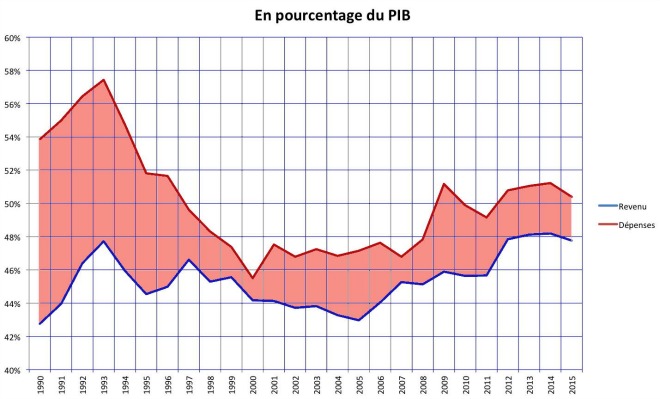Professeur émérite des Universités, Shmuel Trigano est un philosophe et sociologue, spécialiste de la tradition hébraïque et du judaïsme contemporain.
Après l'attentat de Nice et le meurtre du prêtre de Saint Etienne du Rouvray, la France s'est retrouvée à nouveau plongée dans une atmosphère qui rappelle celle que décrit admirablement Albert Camus dans La Peste, quand un mal profond mais inommé ronge l'ambiance de la ville d'Oran. Le dispositif mis en place depuis Charlie Hebdo et dont la commémoration de la tuerie de Toulouse avait constitué un prototype ne «prend» plus.
La stratégie du déni
Je fais référence au cérémonial qui s'est mis en place pour «gérer» chaque attentat.
L'effusion de compassion, qui en est la marque, est ambivalente: si elle accuse le coup de la réalité (reconnaissant qu'il y a des victimes), elle l'engloutit dans l'émotion, pour en annuler de facto le sens (en censurant la motivation que les agresseurs donnent à leur acte, à travers le rite du «pas-d'amalgame»).
Or la réalité est brutale et ne fait pas dans la dentelle.
Les actes terroristes sont commis explicitement au nom de l'islam et leurs perpétrateurs ne se recrutent pas au Moyen-Orient mais parmi les musulmans, en France même, dont ils sont natifs.
C'est aussi dans ce milieu qu'ils trouvent abri et refuge.
Avec le djihadisme mondial «franchisé», qui se développe aujourd'hui, le voisin qui vous dit «bonjour», le fonctionnaire qui vous reçoit, pourrait sans prévenir se transformer en djihadiste armé d'un couteau, d'une hache ou d'une voiture.
La réalité, c'est ce que nomme en l'occultant (là aussi) le «nous sommes en guerre»: une guerre qui ne se mène pas à partir du porte-avion Charles de Gaulle mais sur le sol national et dont témoigne la militarisation de la sécurité publique.
C'est très exactement ce que l'on nommait, avant l'ère du post-modernisme , une guerre civile.
Le gouvernement ne fait que le confirmer lorsqu'il annonce que, même après la défaite du Califat, cette «guerre» ne sera pas finie.
Cette guerre civile est, pour être plus précis, l'effet d'une guerre de religion planétaire.
Le meurtre des non-musulmans est perpétré par les islamistes comme un sacrifice religieux offert à la divinité, un meurtre «moral», «sacré», de même que la mort recherchée du pseudo «martyr» lui ouvre la porte du paradis: un véritable culte de la mort. Il faut comprendre cette logique d'un autre âge, profondément régressive sur le plan de l'histoire humaine (la régression de la religion au sacrifice humain!), pour comprendre le motif de tous ces massacres.
Cette explication n'est pas un commentaire de ma part.
Elle découle de sources coraniques et elle est confirmée par l'imam Qaradawi, qui siège au Qatar, pays ami de la France, et qui est le chef du Conseil de la Fatwa pour l'Europe, le mentor sur la plan de la Charia des Frères Musulmans (et donc de leurs émules français). Dans ses décisions juridiques , il justifie le meurtre des non musulmans, et avant tout des Juifs, comme un moyen licite de défendre et illustrer l'islam.
Il va même jusqu'à estimer que, si le «martyr» le juge nécessaire, le meurtre des non-musulmans pourrait s'accompagner, pour le succès de l'opération, de la mort de musulmans (ainsi expédiés illico presto au paradis). Sur ce dernier point, celà montre parfaitement que le fait que les attentats frappent aussi des musulmans ne diminue en rien le caractère et la justification exclusivement islamiques de ces actes.
À ce propos, il est pitoyable de voir journalistes et experts se perdre en conjectures sur les motifs des massacres et entraîner avec eux un public sidéré et égaré, parce qu'ils se refusent à voir la réalité en face...
Cette réalité - vécue objectivement dans l'inconnaissance -, le Pouvoir, par sa faiblesse et ses idées fausses, ne veut ni ne peut la nommer.
C'est la fonction que remplit le deuxième rouage du dispositif dont la finalité est de «naturaliser» la menace. Le slogan «il faut vivre avec le terrorisme - il y aura d'autres attentats» en est l'expression.
Le Pouvoir traduit sa défaite en rase campagne sous la forme d'une injonction qui conjure l'état de guerre civile potentielle par l'affirmation d'une solidarité espérée («tous ensemble/restons unis/le terrorisme veut nous diviser») mais que les attentats érodent l'un après l'autre.
Ce cérémonial est devenu inefficace. Les huées de Nice contre le gouvernement traduisent quelque chose de profond: l'échec de la doctrine sécuritaire de l'Etat. La situation que j'ai tenté de décrire démontre sa défaillance à l'épreuve de la réalité. Toutes les actions qu'elle promeut dans le domaine sécuritaire ne peuvent être que cautère sur une jambe de bois. Elle présente un vice de forme stratégique qui retentit sur la tactique.
Les valeurs légitimantes: la «morale»
Cette politique se veut «morale» et «démocratique», étayée sur des valeurs (un mot qu'invoque souvent le ministre de l'intérieur) comme: le «pas d'amalgame», l'État de droit, la démocratie. À l'examen, cependant, ces valeurs ne sont ni réalistes, ni honorées.
Où est l' «état de droit» quand les «droits du citoyen» - le droit minimal à la sécurité - ne sont pas assurés?
Que sont ces «droits de l'homme» s'ils assurent avant tout les avantages des terroristes et de leurs apprentis?
L'Etat met en place une armada institutionnelle (jusqu'à un cadre de convalescence mentale pour les djihadistes retour de Syrie!) pour surveiller les futurs djihadistes (fichés «S» et autres) afin de ne pas attenter à leurs «droits de l'homme», quand il faudrait donner un coup de pied définitif dans la fourmilière. On attend que le meurtrier passe à l'acte pour l'arrêter au lieu de l'empêcher de commettre son acte. C'est là une moralité sans réciprocité qui prône le sacrifice des victimes.
Quant à l'état de droit, il est par définition suspendu en «état de guerre» (une proclamation claironnée de toutes part).
Ce que traduit bien la notion juridique d' «état d'urgence». La guerre sur le sol français n'est-elle pas évidente avec ces tueries de masse et l'insécurité de toutes parts?
Quant au «pas d'amalgame», il ne devrait pas empécher de reconnaitre la motivation religieuse islamique des terroristes, expressément proférée dans leurs actes.
L'islam est aujourd'hui entré dans une guerre de religion féroce: interne (chiites-sunnites) et externe, contre l'Occident (sans négliger, sous d'autres cieux, l'indouisme et le judaïsme). Le sunnite sait parfaitement que la guerre que lui fait le chiite est motivée par une interprétation religieuse de l'islam. Pourquoi les non-musulmans s'interdiraient-ils de reconnaître que l'islam inspire aussi aux djihadistes la haine à leur égard?
S'interdire de le faire, évoquer le possible amalgame, c'est au contraire le suggérer en sourdine, de façon massive. C'est une façon de dire que, oui, l'islam est concerné. «N'en parlons pas!»... parce que tout le monde le sait.
On glisse ici d'une situation singulière, particulière (une agression) issue du monde musulman - qui, elle, est condamnable - à la généralité (l'Islam en général) dont elle relève, pour exonérer la première au nom de la préservation de la dernière.
C'est ce que vient vérrouiller dans la machinerie rhétorique, dont le pouvoir médiatico-politique est l'ingénieur, le concept récent, forgé de toutes pièces à cet effet, d' «islamophobie».
Comme si la critique des idées islamiques relevait d'une «phobie», d'une maladie psychique obsessionnelle .
Dirait-on la même chose des critiques athées ou laïques du christianisme ou du judaïsme? Bien évidement, non. La lutte contre l' «islamophobie» identifiée à la lutte conre le racisme a pour finalité d'interdire tout débat idéologique comme politique sur l'islam, ses actions, quelles qu'elles soient, et ses présupposés. Le terme indique bien que l'islamophobie ne relève pas de la lutte contre le racisme et la discrimination mais de la défense et illustration d'une religion et de ses représentants et donc de la censure de toute critique à son égard .
Le «pas d'amalgame» s'y inscrit. Il instaure un privilège en sanctuarisant une seule religion dans l'Etat.
Avec une telle morale, la réalité, et la menace, ne peuvent que se dissiper dans le brouillard: on évoque ainsi «Le terrorisme», «La radicalisation», «La barbarie»... là où il s'agit, dans la bouche même des assassins, d'une guerre de religion. Mais «la vie doit continuer» comme si de rien n'était, ce qui donne un drôle de cocktail psychique dont on se demande ce qu'il produira en bout de parcours! Aujourd'hui, c'est manifestement l'égarement, l'abandonisme, l'angoisse. Le Français moyen ne comprend rien à ce qui se passe. On a le sentiment de s'enfoncer dans une lente agonie. Le titre d'un livre écrit par l'époux d'une victime du Bataclan, Vous n'aurez pas ma haine (Antoine Leiris, Fayard 2016), exprime bien l'égarement du public. Qu'auront-ils donc? Mon amour? Mon respect? Mon dédain? Tel n'est pas le problème! Le désir de vengeance devant l'injustice et l'ignominie est au contraire un sentiment très sain. C'est la base de la justice quand elle est maitrisée par la Loi. L'étouffer, c'est nécessairement retourner contre soi la violence qu'on a reçue de l'agresseur, accepter une condition de victime née et passive face à l'ignominie: un boulevard pour le crime. Plus la défaillance de l'Etat à assurer la sécurité se répète, plus la compassion devient un sentiment et un comportement débilitants.
Le précédent de la lutte contre l'antisémitisme: 13 caractéristiques
Pour l'observateur attentif de la situation française , les éléments de ce tableau, ce «boulevard pour le crime», étaient déjà tous réunis depuis le début des années 2000, lorsque les agressions antisémites ont commencé à se multiplier pour conduire là où nous sommes présentement.
1) Entre la fin de 2000 et 2002 (quand Sarkozy devint ministre de l'intérieur, prenant la suite du socialiste Daniel Vaillant, en mai 2002) se produisirent plus de 500 agressions antisémites, sur lesquelles régna un black out total dans les médias, les pouvoirs publics et les institutions juives. La liste était pourtant très bien tenue . C'est ce black out, inexplicable alors, qui m'avait conduit à créer en 2001 l'Observatoire du monde juif dont la finalité visait à informer l'opinion publique et la classe politique, les médias, de ce qui se passait. C'est aussi ce qui avait conduit le commissaire Sammy Ghozlan à créer à la même époque le Bureau National de Vigilance Contre l'Antisémitisme. Celà génait le judaïsme officiel que l'on parle d' «antisémitisme»... Nous en eûmes l'explication (à la fois de cette gène et surtout de ce black out) quelques années plus tard, de la bouche de Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur alors, quand nous apprîmes que l'ordre (?) en était venu du gouvernement Jospin afin de «ne pas jeter de l'huile sur le feu». L'étonnement de constater que toute une société, réputée pluraliste et libre, y compris la communauté juive, acceptèrent alors de se soumettre à cet ordre est toujours entier. On ne croyait avoir vu celà qu'en Union Soviétique
C'était une erreur politique gravissime, aux graves implications pour la France (et la «démocratie»):
1) Il sacrifiait la sécurité des citoyens d'origine juive pour sauvegarder la «paix publique», mais laquelle? Les agressions antisémites dénotaient de facto une situation de guerre civile quand des citoyens d'origine musulmane s'attaquait à d'autres concitoyens parce qu'ils étaient d'origine juive... La paix civile, qui n'était pas encore l'inénarable «vivre ensemble» impliquait ainsi le sacrifice de la société, du moins d'une de ses parties. Le «tous ensemble» suppose toujours un «bouc émissaire»!
2) Il impliquait le refus programmatique de nommer et d'identifier les faits, ce qui n'empêcha pas l'invention d'un nouveau narratif de la réalité. Comme le révélait la liste des agressions, les agresseurs provenaient de contrevenants d'origine maghrébine ou sud-saharienne. Pour ne pas le reconnaître, les faits furent escamotés et dénaturés.
3) On cacha l'antisémitisme derrière des mots valises: «conflit inter-communautaire», «conflit importé», des formules assassines qui contribuaient à culpabiliser aussi les victimes pour ce qu'elles subissaient.
4) Comme les faits n'étaient pas reconnus comme «antisémites» on leur trouva des justifications «sociologiques» (le chômage, la pauvreté, l'»apartheid social» selon Valls) ou psychologiques (l' «humiliation» arabe , supposée héritée du colonialisme, les problèmes psychologiques) qui exonéraient systématiquement les agresseurs et culpabilisaient les victimes.
5) La faute fut plus précisément reportée sur une extrême droite pourtant presque totalement absente de cette scène. Pendant des années, on la fustigea au lieu de combattre l'antisémitisme islamique. Rappelons nous la stupéfaction engendrée par le massacre commis par Mohamed Merah. Une manifestation «spontanée» se déroula à Paris, conspuant le Front National, supposé être la seule cause de l'antisémitisme!
6) La faute fut aussi reportée sur les Juifs et Israël. Le mythe d'une «communauté juive agressive» hanta le discours médiatique. Israël fut accusé d'être à l'origine des troubles de la société française. L'antisionisme devint le contre-récit des vérités cachées. Moins on reconnut le caractère franco-français (et islamique) des agressions, plus on accabla Israël. Le sionisme devint ainsi le nom d'une mystification obscure, le bouc émissaire logique du mensonge originel sur les faits. Les médias, avec en tête l'AFP, présentèrent systématiquement une version biaisée du djihad palestinien. Toute la société française, en tout cas ses médias, partagèrent le haro sur Israël.
7) Les islamistes et autres activistes y trouvèrent un créneau légitimant leur montée sur la scène politique. C'est la cause palestinenne qui a été la clef de l'entrée de l'islam dans la politique française, avec l'accord tacite de celle ci. Le ministre des affaires étrangères d'alors, Hubert Védrine alla même jusqu'à déclarer «comprendre» pourquoi des «jeunes de banlieue» s'attaquaient à des Juifs (leurs concitoyens!) à la lumière de «ce qui se passait» en Israël. L'antisionisme a ainsi rempli trois fonctions. Outre qu'il sert de vecteur de rapprochement aux sympathisants des islamistes, qui s'identifient ainsi à leur haine la plus forte, il procure à ces derniers une voie d'accès «consensuelle» à la scène politique française (puisqu'il est censé être politiquement moral), en même temps qu'il fournit aux deux mouvances une couverture supposée légitime à ce qui est fondamentalement de l'antisémitisme .
L'antisémitisme du djihadiste est la cause de son «antisionisme», le sionisme incarnant la liberté du Juif se rebellant contre la prison sociale, politique et existentielle que lui réserve la Charia.
8) Comme le coupable de cet état de faits était Israël et ceux qui le «soutenaient», la crise fut tenue pour ne pas concerner la société française. On renvoya dos à dos «les deux communautés» (selon l'expression violente de Mitterand après la guerre du Golfe, désignant «deux communautés» dans la société française) mais ce sont les Juifs qui furent sur la sellette. Quand ils nommaient leurs victimes, ils furent qualifiés de «racistes», de «communautaristes», voire (Alain Minc) d'être les introducteurs du communautarisme en France, ce qui revenait à dénationaliser en masse des Français qui l'étaient pour la majorité (les originaires d'Algérie) depuis 1870 (bien avant Alain Minc!). Quand ils désespérèrent d'être entendus et finissaient par quitter la France, ils se virent qualifiés (Christophe Barbier dans un scandaleux éditorial de L'Express) de «Baal Zevouv» (Belzebuth!), ou comparés (par Pierre Conesa, haut fonctionnaire, auteur de Guide du petit djihadiste, (Fayard, 2016)) aux djihadistes partant en Syrie, le même spécialiste conseillant à la France d'adhérer à l'Organisation de la Conférence Islamique (dont la capitale déclarée - mais quel «expert» le sait? - est «Al Kuds», soit Jérusalem quand elle sera «libérée»).
9) En somme les victimes furent niées, désidentifiées, exclues symboliquement, vilipendées, et dans le meilleur des cas enfermées derrière des barrières de protection policière, les isolant ainsi du reste de la société française pour mieux sauvegarder «la paix publique». On sacrifia la victime pour ne pas avoir à livrer bataille contre le bourreau. Il fallut attendre «le Français Merah» (expression journalistique typique) pour que l'on accepte enfin, avec un «étonnement» illégitime, que la crise concernait la société française. Et que, peut-être, il fallait faire quelque chose!
10) Comme l'Etat et la Justice se sont avérés incapables d'identifier qui était la victime, qui était l'agresseur, comme ils ont supposé que la victime était complice de l'agresseur, ils optèrent pour une politique de «conciliation» et de «pacification» - pour de bon communautaro-religieuse cette fois-ci, là où il fallait qu'il exerce sa souveraineté. L'Etat se fit le grand ordonnateur d'un «dialogue des religions», comme s'il confiait aux religions la capacité et la responsabilité de faire la paix et comme si toutes les religions étaient en guerre. Sur le plan politique, cela revenait à reconnaître la défaillance de l'Etat et du ministère de l'intérieur.
11) Cette politique erronée ramenait, par la bande, le christianisme et le judaisme à une condition qu'ils avaient dépassée depuis Napoléon 1er et à laquelle l'islam n'a pas encore accédé pour des raisons historiques très simples . Dans le discours médiatique, l'accusation fut lancée contre toutes les religions, pour ne pas la porter contre l'islam qui, seul, pose problème aujourd'hui au regard de la démocratie sur le plan de son retard de modernisation et du fait d'une situation nouvelle où il se retrouve minoritaire, ainsi au sein de nations (si elles existent encore en Union Européenne) et non d'un empire.
11) Au lieu que l'Etat impose un ordre sécuritaire de lui même, on chargea les religions de trouver un modèle de «pacification». Plutôt que le modèle de la République, on chanta les louanges du mythe historico-politique de «l'Espagne des trois religions» (sous l'ordre de la Charia!), un mythe hissé gravement au hit parade de l'Education nationale ... Le «vivre ensemble» - traduction «républicaine» de ce mythe - devînt la scène de la défaite de l'Etat et tout spécialement de la République. Ce slogan désigne effectivement le contraire de l'»être ensemble», soit un ordre social marqué par l'existence de collectivités séparées et discriminées juridiquement sur le plan du pouvoir politique mais sous la houlette coercitive de l'ordre juridique d'une seule «communauté». On se demande comment ce modèle détestable aux yeux des valeurs modernes, sorti tout droit du haut Moyen âge, a pu inspirer tant d'activisme politico-culturel.
12) Les autorités républicaines purent même affirmer des convictions théologiques en faveur de l'islam, «soluble dans la République» (Hollande à Tunis), se faire les promoteurs de son innocence de principe, là où les autres religions étaient mises en cause de façon sourde mais omniprésente. On accrédita une mouvance politique dangereuse, les Frères musulmans, à la tête de l'UOIF, ses partisans furent chéris par les plateaux de télévision et les politiciens (tragiquement incompétents en la matière). Tout un pan de l'opinion française fut, par contre, écarté de la scène et stigmatisé.
13) Les éléments de langage journalistique achevèrent de rendre la situation incompréhensible. La première page de Libération du 16 juillet 2016, intitulée «Pourquoi?» vaut son pesant d'or, ce journal posant, après Nice, la question du pourquoi d'une situation qu'il a très fortement contribué à créer. J'ai en mémoire notamment trois pages de célébration d' un livre réputé sociologique, La tentation antisémite de Michel Wievorka (Robert Laffont, 2005), qui soutenait avec force «enquêtes» qu'il n'y avait pas d'antisémitisme en France mais qu'il y avait par contre un «communautarisme» juif qui provoquait les «banlieues populaires»... Pas besoin de dire que les faits, sur le moment même - et oh combien après! - ont démontré l'inanité de cet argument.
Le début de la fin de la stratégie du déni
Deux faits ont ébranlé la stratégie du déni: l'affaire Mérah, par laquelle les médias découvrent qu'un «Français» (l'expression «le Français Mérah» fut répétée à l'envi dans les médias), né en France, pouvait devenir meurtrier de Juifs, sans rapport direct avec Moyen Orient, ni avec la condition d'immigré et sous le prétexte fallacieux de «venger les enfants de Gaza» (justement, qu'est-ce que le discours médiatique français a pu écrire sur Gaza?) Mais la controverse autour de l'immigration en Israël, lancée à cette occasion par l'invitation de Natanyahou aux Juifs de France, montre qu'on ne comprenait toujours pas les raisons pour lesquelles des Juifs s'en allaient.
C'est alors que la stratégie de la compassion fut mise en œuvre, quoique de façon limitée. Le massacre de Charlie Hebdo fut le déclencheur de l'universalisation du danger qui ne planait jusqu'alors, croyait-on, que sur les Juifs (déjà mis à l'écart de facto de la société entière pour raison sécuritaire), et ne dépasserait pas les barrières entourant leurs lieux privilégiés. Sans Charlie Hebdo, le massacre de l''Hyper-casher serait resté dans sa petite case et derrière son cordon de sécurité qui l'isolait de la société. Charlie Hebdo vit aussi le triomphe de la compassion massive, le sentiment dominant du «vivre ensemble» ...
Alors, et de plus en plus par la suite, il est devenu clair que c'est toute la société qui est menacée et pas uniquement les Juifs - quoique toujours eux, aussi, électivement. L'enclos sécuritaire dans lequel ils avaient été enfermés (et exclus) englobe maintenant toute la société. L'idée qu'Israël est toujours coupable subsiste cependant. Il n'est que de voir le traitement discriminant que l'AFP fait, ces jours ci même, du djihadisme palestinien et du djihadisme français. L'agresseur (des Israéliens, ou plus précisément des «Juifs») , est toujours exonéré, là où, en France, il est (quoiqu'à peine) condamné mais toujours pas nommé ni ramené à son motif religieux - jusqu'au comique.
Ceci explique pourquoi le «nouvel» antisémitisme fut au cœur de la situation française, comme le laboratoire, durant 15 ans, de ce qui s'y tramait. Il en est la clef. Michel Houellebecq traduit cet état de faits, à sa manière, dans Soumission , en mettant dans la bouche de son héros que sa petite amie juive quitte pour Israël devant l'avancée islamique: «il n'y a pas d'Israël pour moi, une pensée bien pauvre; mais une pensée exacte».
SOURCE www.figaro.fr
PS: ARTICLE M A G N I F I Q U E QUI RESUME PARFAITEMENT LA REALITE DES CHOSES!